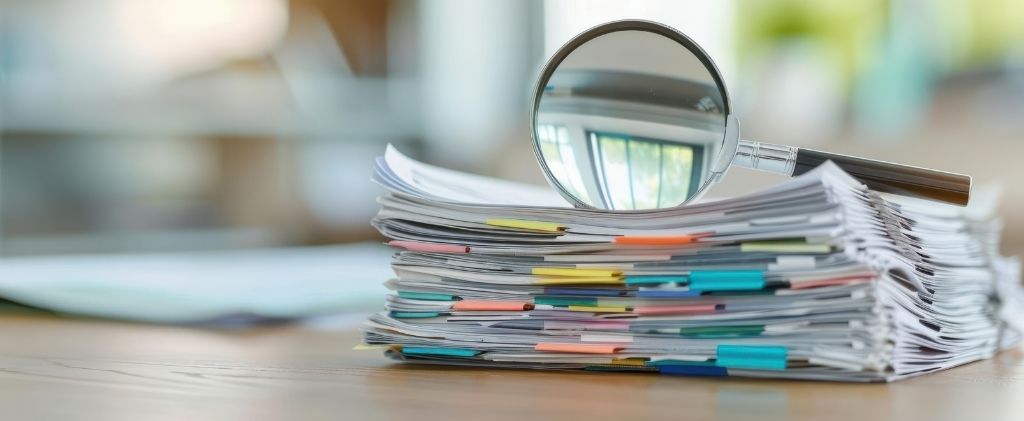Dans un contexte de retard et donc d’absence actuelle de la feuille de route gouvernementale claire sur la programmation énergétique à moyen terme, la PPE3, un texte parlementaire fait l’actualité : la proposition de loi Gremillet, portée par le Sénat.
À retenir :
La proposition de loi Gremillet structure actuellement le débat énergétique en France. Elle vise à définir les priorités et ainsi poser les jalons des choix énergétiques, dans un contexte de retard de la PPE3 et d’absence de cap gouvernemental clair. Un clivage fort s’est créé, principalement entre la gauche et l’extrême doite, autour du choix du nucléaire comme pilier du mix énergétique futur.
🔦 Lumière sur les thèmes abordés dans cet article
Qu’est-ce que la PPL (proposition de loi) Gremillet ? Qui a proposé la loi Gremillet ?
La PPL Gremillet, nommée d’après son rapporteur, le sénateur Les Républicains Daniel Grémillet, est une initiative du Sénat.
Elle a pour objectif de fixer les choix énergétiques majeurs de la France à l’horizon 2035, notamment la part du nucléaire et des énergies renouvelables dans le mix énergétique national.
Ce texte vise à répondre aux défis du changement climatique, à garantir la souveraineté énergétique de la France et à renforcer sa compétitivité économique.
La proposition s’inscrit dans la continuité de la loi de programmation énergie-climat. Elle ambitionne la relance du nucléaire avec une production d’un minimum de 27 GW de nouveau nucléaire d’ici 2050, ce qui impliquerait la construction de 14 nouveaux réacteurs EPR2 : (6 d’ici 2026, 8 d’ici 2030).
Un texte structurant, mais très contesté
La PPL Gremillet suscite d’intenses débats au sein du Parlement et parmi les acteurs du secteur énergétique.
Arguments en faveur du texte
Les partisans de la loi, majoritairement au Sénat, estiment :
L’énergie nucléaire est essentielle pour atteindre les objectifs climatiques de la France. Ils la considèrent comme une source d’énergie stable, décarbonée et nécessaire à la souveraineté énergétique du pays.
Arguments contre le texte
Les opposants, parmi lesquels des députés écologistes et plusieurs ONG (Greenpeace ou encore Réseau Action Climat), alertent sur les risques associés au nucléaire : gestion des déchets, sécurité des installations, incertitudes économiques, comme le gel d’environ 100 000 emplois du secteur ou encore un retard sur le but européen.
L’écologiste Yannick Jadot pointe les zones d’ombre : « Quels seront les impacts de cette loi sur le prix de l’électricité ? Sur le montant nécessaire d’investissements publics ? Sur notre trajectoire climatique ? Sur notre souveraineté ? On n’en sait rien. C’est irresponsable »
Ils dénoncent un déséquilibre au détriment des énergies renouvelables, malgré l’abandon du moratoire, et regrettent que des filières comme l’agrivoltaïsme, la méthanisation ou les biocarburants soient peu mises en avant.
Quel serait son éventuel impact économique ?
Si la loi était adoptée, elle pourrait stimuler la création d’emplois dans le secteur nucléaire. Cependant, elle pourrait également entraîner une augmentation des coûts de l’énergie pour les consommateurs.
Des projections économiques, comme celles de l’Institut Montaigne, indiquent que les investissements dans le nucléaire pourraient atteindre plusieurs milliards d’euros d’ici 2050, avec un impact significatif sur la croissance économique et l’emploi dans les régions concernées.
Toutefois, il est reconnu que les infrastructures de production d’énergie nucléaire sont très coûteuses, avec des investissements se comptant en milliards d’euros et un retour sur investissement étalé sur plusieurs décennies.
Contexte international et implications environnementales
À l’échelle internationale, les politiques énergétiques divergent.
Des pays comme l’Allemagne ont choisi de sortir progressivement du nucléaire, tandis que d’autres, comme la Chine, investissent massivement dans cette source d’énergie. La Chine prévoit notamment de construire plus de 150 nouveaux réacteurs nucléaires d’ici 2035, ce qui en ferait le leader mondial en termes de capacité nucléaire installée. La France se positionne ainsi comme un acteur clé en Europe en matière de politique énergétique nucléaire.
Où en sommes nous ?
Après avoir été rejetée par l’Assemblée nationale le 24 juin dernier (377 voix contre, 142 pour), la PPL Gremillet a été adoptée par le Sénat en deuxième lecture hier le 8 juillet 2025, par 221 voix contre 24. Ce vote du Sénat marque une nouvelle étape pour ce texte controversé.
Il est important de noter qu’un moratoire (entendre : ralentissement) sur les nouvelles installations éoliennes et photovoltaïques, qui avait suscité de vives réactions à l’Assemblée nationale, n’est plus d’actualité en raison des règles de procédure parlementaire et ne figure plus dans le texte actuel.
Malgré l’adoption par le Sénat, le calendrier s’annonce serré. Les sénateurs ont plaidé pour que le gouvernement attende l’adoption définitive de cette loi pour finaliser sa programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), mais le ministre a assuré que le décret de la PPE serait publié « avant la fin de l’été », un délai incompatible avec les prochaines étapes parlementaires de la PPL Gremillet.
FAQ - mieux comprendre la situation
Qu'est-ce qu'une proposition de loi ?
Une proposition de loi est un texte législatif déposé par un ou plusieurs membres du Parlement (députés ou sénateurs) visant à créer, modifier ou abroger des lois. Elle suit une procédure parlementaire spécifique pour être discutée, amendée et éventuellement adoptée.
Où consulter les propositions de loi ?
En France, les propositions de loi peuvent être consultées sur les sites officiels de l’Assemblée nationale et du Sénat. Voici les liens utiles :
Ces sites permettent d’accéder aux textes des propositions de loi, à leur statut dans le processus législatif, ainsi qu’aux débats et amendements associés.
Comment fonctionne une proposition de loi ?
Le parcours d’une proposition de loi : étapes clés
Dépôt du texte
Tout commence par le dépôt d’une proposition de loi, rédigée par un ou plusieurs parlementaires. Elle est déposée auprès de la présidence de l’Assemblée nationale ou du Sénat.Passage en commission
La proposition est ensuite confiée à une commission permanente compétente. C’est là qu’elle est examinée en détail et, si nécessaire, amendée pour en préciser ou corriger certains points.Débat en séance publique
Le texte passe ensuite devant l’ensemble des députés ou des sénateurs, réunis en séance plénière. Les parlementaires peuvent y défendre des amendements et débattre du fond du texte.Vote de la chambre
À l’issue des échanges, le texte est soumis au vote. S’il est adopté, il passe alors entre les mains de l’autre chambre pour suivre le même processus d’examen.Navette parlementaire
C’est le jeu des allers-retours entre l’Assemblée nationale et le Sénat. Les deux chambres doivent se mettre d’accord sur une version commune du texte. Ce dialogue peut parfois durer plusieurs lectures.Adoption définitive
Quand les deux chambres adoptent le même texte dans les mêmes termes, la proposition devient une loi. Elle est alors transmise au Président de la République.Promulgation et entrée en vigueur
Le Président promulgue la loi, qui est publiée au Journal officiel. Elle entre alors en vigueur.
Et en cas de blocage ?
Si les deux chambres ne parviennent pas à un accord, une commission mixte paritaire (CMP) peut être convoquée pour trouver un compromis. Et si le désaccord persiste, le gouvernement peut décider de donner le dernier mot à l’Assemblée nationale.
Quelle est la différence entre un projet de loi et une proposition de loi ?
- Projet de loi : Il est initié par le gouvernement. Cela signifie que c’est le pouvoir exécutif qui propose le texte législatif, généralement préparé par un ministère en fonction des priorités gouvernementales.
- Proposition de loi : Elle est initiée par les membres du Parlement, c’est-à-dire les députés ou les sénateurs. Cela permet aux législateurs de proposer des lois indépendamment de l’agenda du gouvernement.
C'est quoi, la programmation pluriannuelle de l’énergie 2025 (PPE 3) ?
La Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) 2025-2035 est la feuille de route stratégique de la France pour la décennie à venir.
Elle fixe des objectifs chiffrés pour la production, la consommation et l’électrification des usages, en cohérence avec la neutralité carbone visée en 2050.
La PPE influence directement les investissements, les aides publiques, la sécurité d’approvisionnement et les prix de l’énergie pour les entreprises et les consommateurs.
Elle s’appuie sur des scénarios robustes, des coûts de production actualisés, et une concertation large avec les parties prenantes, dont l’Association négaWatt, qui alerte régulièrement sur la nécessité d’accélérer la transition vers les renouvelables et la sobriété énergétique.
Quelle est la dernière loi votée à l’Assemblée nationale en 2025 ?
En 2025, l’Assemblée nationale a adopté plusieurs projets de loi structurants pour la transition écologique, notamment sur l’économie circulaire et la décarbonation industrielle.
Toutefois, la proposition de loi Gremillet a été rejetée lors de son premier passage, illustrant les tensions persistantes sur les choix énergétiques à opérer.
Quels sont les objectifs de la loi de transition écologique ?
La loi de transition énergétique vise à :
- Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % d’ici 2030 et de 75 % d’ici 2050.
- Réduire la consommation énergétique finale de 50 % d’ici 2050.
- Porter la part des renouvelables à environ 33 % de la consommation finale brute d’énergie en 2030 (un objectif inférieur aux ambitions européennes).
- Ramener la part du nucléaire à 50 % dans la production d’électricité à l’horizon 2035.
- Accélérer l’électrification des usages pour décarboner l’industrie, le bâtiment et la mobilité.